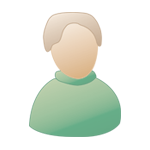Bienvenue invité ( Connexion | Inscription )
 16/11/2006 à 15:23 16/11/2006 à 15:23
Message
#1
|
|
|
Expert +        Groupe : Érudit Messages : 11 645 Inscrit : 18/09/2005 Lieu : Avignon (Vaucluse) Membre no 2 Aide possible: sur le fond et la forme Logiciel: Heredis |
Cloutiers
From: "Pierre Piquart" <..> Date: Sat, 15 Nov 2003 10:36:19 +0100 Pour ceux que l'histoire locale intéresse (Extrait de la vie d'un paysan ardennais) : Il y avait des boutiques qui étaient terriblement petites et parfois l'on travaillait là-dedans à 7-8 presque sans lumière. Parfois l'on se cognait au plafond et il y avait parfois une petite lucarne dans un coin pour donner de l'air. Quand le vent était mal placé, la fumée revenait par la cheminée dans la boutique et il y avait parfois une chaleur épouvantable. Les chiens mordaient parfois les jambes et souvent il y avait des puces. J'en ramassais bien ma part. Enfin on n'y pensait pas. Presque tous les ouvriers ne se lavaient qu'une fois par semaine. Dans quel état ils étaient parfois ! Ils avaient les yeux enflammés. Les tasses ou écuelles pour manger, les fourchettes ou cuillères n'étaient jamais lavées et on les mettait sur une planche avec un centimètre de crasse ou (« faigine »). J'ai vu des tasses aussi noires que le charbon. Il n'y avait pas d'essuie-mains. Pour mettre le pain, on le posait aussi bien sur la niche du chien ou bien il tombait à terre et on le ramassait en l'essuyant avec la manche de son paletot qui était encore plus noire. Complément Date: Sat, 15 Nov 2003 16:21:21 +0100 Complément reçu de Pierre Piquart que j'ai remercié au nom de tous les abonnés. Il dit ceci : """Ce livre de Paul Manil a été publié à compte d'auteur et est malheureusement introuvable.Né en 1890 en Belgique près de la frontière française, à une quinzaine de kilomètres de Charleville (où j'habite), il a publié ce livre de 320 pages en 1966. Il a écrit deux suites à cet ouvrage, dont au moins une a été publiée (j'ai pu la retrouver et en faire faire une photocopie). Ces livres sont très attachants, car très naturels. Paul Manil les a écrit comme il parle. Il n'avait aucune instruction et le dit. Les ouvrages sont bourrés de fautes d'orthographe, de Français, de frappes. Il n'y a aucun ordre dans ses récits et on passe tout le long des bouquins de 1810 à 1850 pour revenir à 1820...etc.. Voici ces extraits : Paul MANIL - La vie et les mémoires d'un paysan ardennais LA CLOUTERIE J'avais eu 11 ans le 10 août 1901, et en septembre j'allais apprendre à faire des clous. Un lundi me voilà parti à ROGISSART ; je portais la marmite de soupe, j'avais de gros sabots couverts, des grands bas noirs et des culottes courtes. Ma mère m'avait fait une bannette, tablier en cuir que l'on met devant soi pour se protéger des paillettes de fer rouge. Au début, comme apprenti, je commençais à 9 heures et terminait à quatre heures (le quatrième mois je gagnais déjà deux francs par semaine, à 14 ans dix à douze francs). Nous travaillions à six dans la boutique. Le matin, avant de partir, je mangeais un morceau de pain sec trempé dans du café. A midi quelques pommes de terre que l'on faisait cuire dans les cendres du feu. Le soir des pommes de terre et du pain, parfois « un crêton ». Parfois ma mère me donnait trois sous pour acheter deux saurets (poisson fumé), treize sous pour acheter deux fromages (par deux on gagnait un sou). Une à deux fois par semaine passait un boucher de cheval de NOUZONVILLE : douze sous le kilogramme de cheval avec lequel on faisait la soupe, douze sous la livre de saucisson. A ROGISSART vers 1880 et 1890 il y avait environ 300 ouvriers et ouvrières. En 1902 et 1903 il y avait encore près de 60 chiens pour tourner la roue et actionner le soufflet, pour attiser le feu. Il fut un temps où il y avait plus de 130 chiens. Le chien de celui qui allumait le feu vers cinq heures tournait la roue jusqu'à huit heures et demie, un autre de neuf à douze heures, un autre de une heure à quatre heures et le dernier de quatre heures et demie à huit heures. S'il n'y avait que deux chiens l'un tournait de neuf heures à midi, et de quatre heures et demie à huit heures ; l'autre de cinq heures à huit heures et de une heure à quatre heures. Ils étaient appelés par les « cloteux », les « moteurs à puces ». Pas de cabinets pour les besoins et on se posait derrière les haies. A quinze ans je gagnais presque le double de la plupart des cloutiers (dix sous de plus à la botte de fer de 18 à 19 kilogrammes). Les noceurs : dans quel état était tous ces noceurs quand ils devenaient vieux, principalement les vieux garçons. J'en ai vu qui n'avaient même pas de lit pour se coucher, quelques sacs et des vieux papiers dans un coin pour servir de couchette. Pas un franc pour acheter de la nourriture. Il y avait un nommé Léon qui faisait la soupe, à la boutique, avec de la chandelle et il mettait du pain dedans et cela sentait mauvais et il se régalait. Et en été il faisait une compote de grosses limaces rouges ou jaunes et mettait cette compote sur son pain. Il prenait des rondelles avec la pointe de son couteau et les mettait dans la bouche. Je l'ai vu aussi prendre des rats au piège, les vider et les mettre sur deux morceaux de fer sur le feu de houille. Nous étions obligés de nous sauver de la boutique tellement cela sentait mauvais. Quand il jugeait qu'ils étaient cuits il les mangeait. Il couchait dans la boutique sur la chaufferie près du feu. Un jour, le premier ouvrier en arrivant le trouva à moitié carbonisé ; il était sans doute rentré dans les vignes et s'était couché sur le feu. Voilà comment beaucoup de ces épaves finissaient leur vie brûlés, noyés, pendus ou en prison. Revenons un peu à ROGISSART avec les cloutiers. J'ai déjà dit que les femmes et les jeunes filles travaillaient aussi le fer. Il y avait des boutiques qui étaient terriblement petites et parfois l'on travaillait là-dedans à 7-8 presque sans lumière. Parfois l'on se cognait au plafond et il y avait parfois une petite lucarne dans un coin pour donner de l'air. Quand le vent était mal placé, la fumée revenait par la cheminée dans la boutique et il y avait parfois une chaleur épouvantable. Les chiens mordaient parfois les jambes et souvent il y avait des puces. J'en ramassais bien ma part. Enfin on n'y pensait pas. Presque tous les ouvriers ne se lavaient qu'une fois par semaine. Dans quel état ils étaient parfois ! Ils avaient les yeux enflammés. Les tasses ou écuelles pour manger, les fourchettes ou cuillères n'étaient jamais lavées et on les mettaient sur une planche avec un centimètre de crasse ou (« faigine »). J'ai vu des tasses aussi noires que le charbon. Il n'y avait pas d'essuie-mains. Pour mettre le pain, on le posait aussi bien sur la niche du chien ou bien il tombait à terre et on le ramassait en l'essuyant avec la manche de son paletot qui était encore plus noire. Les Chiens J'ai déjà dit qu'il y avait plus de 100 chiens dans ce petit village et qu' il y avait toujours des chiennes qui étaient en chaleur et alors les chiens se battaient et culbutaient tout dans la boutique. Parfois on était obligé de monter sur la chaufferie pour ne pas se faire mordre. D'autres chiens qui étaient dans la rue, en entendant leurs camarades se battre, entraient aussi dans la boutique et prenaient part à la lutte. Un jour dans notre boutique, il y en avait bien vingt qui se battaient ensemble. Nous avons du nous sauver par la fenêtre. Du dehors nous ne savions plus ouvrir la porte car il y en avait 7 ou 8 qui se battaient derrière et il y en avait qui râlaient. Ceux qui avaient des chiens dans la bataille voulurent aller les séparer. Ils se sont battus plus d'une demi-heure et nous étions parvenus à ouvrir la porte et ils en sont sortis un à un. Ils étaient à bout n'en pouvant plus. Un avait une oreille arrachée, l'autre se sauvant en levant sa patte, un autre un oil dehors de sa tête ou autre chose. Si la chienne sortait, cela recommençait sur la route et parfois il y en avait 50. Parfois aussi il y avait des hommes dessus qui frappaient avec des bâtons, c'était encore pire. Quand ils étaient bien à bout ils retournaient tous dans leurs niches dans les boutiques. Il y en avait qui étaient tellement mal arrangés qu'ils ne savaient plus retourner chez eux le soir et alors on les laissait dans la boutique. Il y avait aussi des hommes qui s'empoignaient par rapport aux chiens, car ils étaient contents quand ils voyaient que leur chien avait le dessus. Il y avait des chiens qui avaient des pointes de deux centimètres à leur collier et c'était toujours ceux-là les plus forts parce que les autres se piquaient la gueule. Comme partout ailleurs les apprentis cloutier sont les souffre douleur et on leur faisait faire les sales besognes. La première année j'ai fait comme les autres, j'allais chercher la houille au dépôt, en bas de ROGISSART, pour la distribuer. Il y avait un comité qui s'occupait de faire venir la houille, puis les voituriers allaient sur des chariots à GESPUNSART ou à NOUZONVILLE. Quand c'était le petit (Toria) qui l'avait ramenée puis un homme qui était payé la distribuait tous les jours de 12 heures à 1 heure, et l'on avait un carnet qu'il marquait quand on allait en chercher, puis il l'inscrivait sur un registre, lui appartenant sans doute pour faire un contrôle malgré que l' on devait payer comptant en l'enlevant. La mesure était 25 Kilogrammes juste plein la brouette. Deux ans après que j'apprenais à faire des clous, c'était toujours moi qui faisait la corvée et je me dis un jour : C'est une vieille mode, les hommes sont plus forts que moi, j'irais à mon tour, un lundi et je n'en avais parlé à personne Après le dîner, j'avais 12 ou 14 ans, mon père me dit : Tu ne vas donc pas chercher la houille ? Je lui répondis : à partir d'aujourd'hui j'irais chercher de la houille quand ce sera mon tour. Il voulut m'y faire aller ,me disant : ne fais pas le drôle ou je te flanque une calotte. Tu sais bien que c'est la mode. Il paraît que je lui avais répondu : Et bien c'est une drôle de mode, à partir d'aujourd'hui j'irais à mon tour. Et voilà une discussion avec les autres ouvriers, et je n'ai pas cédé, et à partir de ce jour-là dans notre boutique, chacun y a été à tour de rôle. Dans les autres boutiques , quand il y avait un apprenti, il disait : je fais comme le «Paul Mélasse », chacun son tour. Deux ou trois ans plus tard, la mode était perdue, l'apprenti commençait à redresser la tête. Les belges n'étaient pas bien vus en FRANCE ; nous devions avoir une feuille de 42 sous, délivrée par la préfecture de MEZIERES. Les Français nous appelaient les 42 sous ou les sales Belges. Je faisais à cette époque des clous dits « mantchos ou manchos », avec du fer plus ou moins en acier et très dur. Il y en avait beaucoup qui avaient essayé et ils avaient attrapé mal à leur poignet et aux bras. Ils avaient du abandonner cette sorte de fer trop fort, il se nommait « mixe », il ne fallait pas le faire chauffer trop fort ou il fondait. Il fallait le travailler plutôt sur le rouge et j'avais cette grande, grande chance, que le fer était comme du plomb sous mon marteau . Il sortait blanc de la clouterie, alors cela faisait de beaux clous bleu acier et je n'avais aucun mal à les faire. Je faisais autant que les autres, si pas plus, car j'étais un des meilleurs ouvriers de BAGIMONT comme cloutier. Je gagnais régulièrement 40 à 45 Francs par semaine où, les autres ouvriers, des bons ne gagnaient que 25 à 30 Francs. Je touchais toutes les semaines deux pièces de 20 Francs en or et de la monnaie et je ne travaillais que huit heures par jour. J'arrivais pour commencer à 9 heures jusqu'à midi, puis de 1 heure à 4 heures et de 5 heures à 8 heures du soir, moins un quart d'heure de repos (tabac) à 11 heures moins le quart, à 3 heures et à 7 heures du soir. Je n'étais jamais fatigué et je voyais des ouvriers 11 et 12 heures par jour de travail, ils n'en pouvaient de fatigue. A n'importe quelle sorte de travail je faisais beaucoup d'ouvrage, mais je me reposais ; quand j'étais au travail je donnais un coup de collier. J'ai remarqué plus d'une fois que ce n'était pas le nombre d'heures qui abattait le plus d'ouvrage. Pour travailler, il faut se reposer et avoir une nourriture suivant les forces que l'on dépense. Vous allez sans doute croire que je me vante et que je me donne des gants, mais c'est la pure vérité. Plus tard nous décidâmes de monter une boutique à BAGIMONT. Nous étions 4-5. Un jour ma mère me dit : « Ben djais clouté quand djetau djaune fiedjet à ROGISSART frau ptette quos ben des claus tin mi ». Comme il y avait une place libre à la boutique, elle se mit à faire des clous avec nous (des deux pointes) et elle faisait de la belle marchandise ; puis comme les clous se payaient beaucoup plus chers qu'à BOHAN, BAGIMONT, nous avons dû redescendre à ROGISSART. Nous avions travaillé deux ans à BAGIMONT. Les ouvriers assez âgés étaient restés quand même et ma mère continuait à faire des clous avec eux. Voici ce que nous faisions avec les clous que ma mère faisait. Nous les portions dans une marmite à soupe à ROGISSART, mais comme les douaniers nous fouillaient parfois, et que c'était moi qui portait la marmite, quand je les voyais et qu'ils ne m'avaient pas vu, je cachais la marmite et j'allais la chercher à midi en me promenant, et le fer nous le reportions le soir, environ 3 kilogrammes par jour. Nous étions appelés les bancales , car beaucoup avaient les jambes toutes de travers. C'était assez fatigant d'être toujours sur ses jambes et bien souvent quand on apprenait à faire des clous, si l'on ne faisait pas attention, l'on prenait vite de mauvaises positions. Plusieurs ont même été estropiés et devaient marcher avec un bâton. Nous mangions souvent un morceau de pain avec un bout de fromage blanc comme de la craie : c'était ce que les autres appelait « le beefteack du cloutier ». |
|
|
|
2 utilisateur(s) sur ce sujet (2 invité(s) et 0 utilisateur(s) anonyme(s))
0 membre(s) :

|
Version bas débit | Nous sommes le : 27 04 2024 à 20:32 |